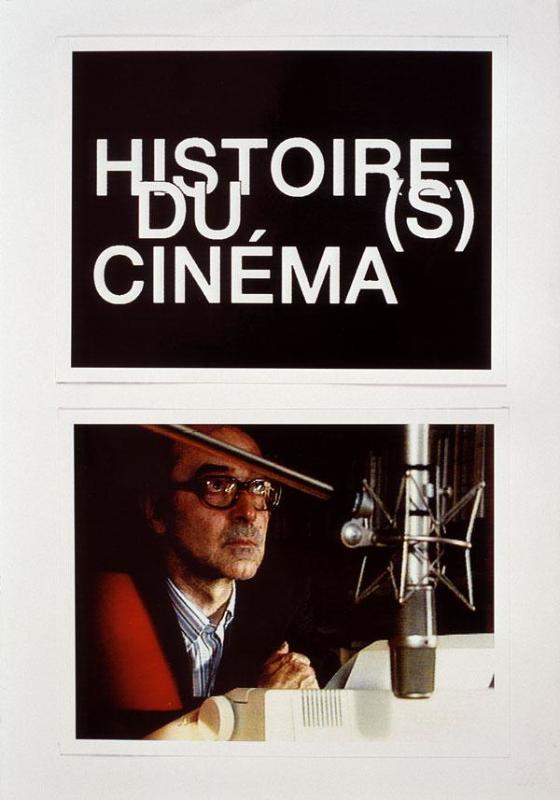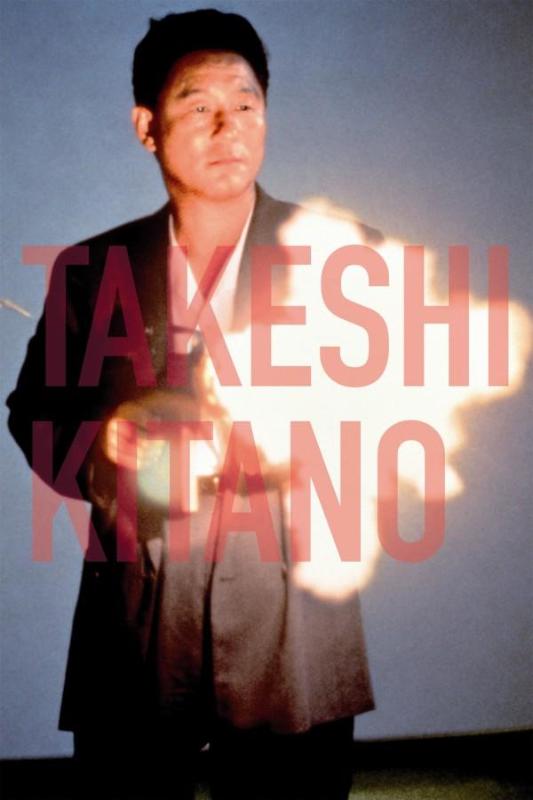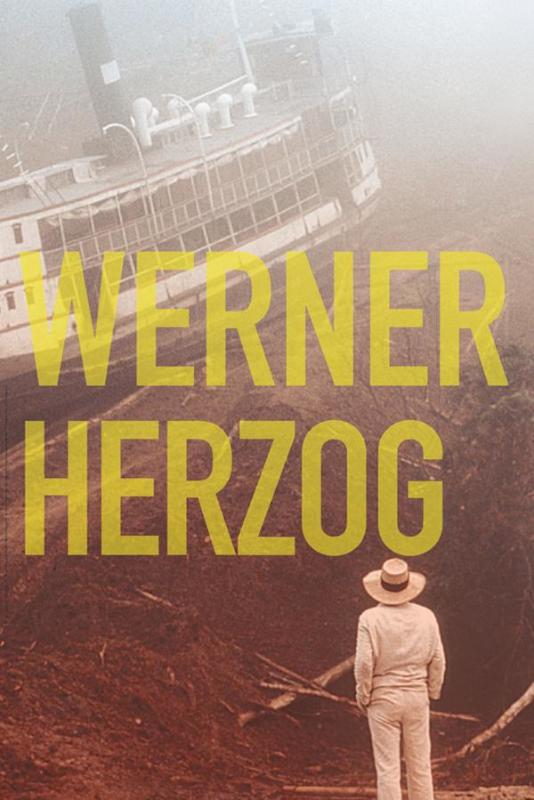De Chantal Akerman à Brian De Palma : 40 ans de cinéma à Beaubourg
À quoi sert le Centre Pompidou pour le cinéma ?
Sylvie Pras — Pour répondre à cette question, il faut revenir aux origines du Centre, inauguré en 1977. Le président Georges Pompidou voulait en faire un lieu de culture qui rassemble tous les arts, y compris le cinéma. À l’époque, en France, il n’existait que les salles d’art et d’essai et celles dédiées au grand public, en plus de la Cinémathèque qui diffusait essentiellement les grands classiques du cinéma. Le rôle du Centre Pompidou, dans ce paysage-là, consistait à montrer la diversité de la production mondiale ; le cinéma hongrois, polonais, portugais… Avec des propositions de rétrospectives exhaustives, accompagnées d’un livre qui devait s’imposer comme un ouvrage de référence sur le sujet traité. Jean-Loup Passek, le critique responsable du fameux Dictionnaire du cinéma chez Larousse, dirigeait les ouvrages et orientait la ligne éditoriale de la programmation.
Cette ambition est-elle toujours d’actualité ?
Sylvie Pras — Plus tout à fait. Au début des années 2000, le paysage parisien avait beaucoup changé. De nombreuses structures diffusaient des productions de cinéphiles ; à l’instar du Forum des images, du Louvre, du musée d’Orsay. Avant, on pouvait montrer trois cents œuvres asiatiques, d’un bloc. Dorénavant, nous ne présenterions plus que le travail rétrospectif de quatre metteurs en scène, en leur présence, accompagné d’une exposition réalisée par leurs soins. Chantal Akerman, l’artiste belge, fut la toute première. C’est un exercice délicat. Certains, comme Bertrand Bonello, qui vient de la musique, y sont arrivés à merveille ; en se concentrant sur le son notamment. En plus de ces quatre temps forts annuels, un festival pluridisciplinaire autour de l'image en mouvement, Hors Pistes, investit le Centre Pompidou et toutes les saisons sont jalonnées par de nombreuses avant-premières.
Vous partez cette année, après plus de trente-cinq années au service du cinéma, quels ont été les moments les plus marquants ?
Sylvie Pras — Il y en a tant. J’ai un très beau souvenir de ma rencontre avec Sergueï Paradjanov en 1989, le réalisateur arménien, que nous étions parvenus à faire sortir d’URSS, où il avait été emprisonné quatre ans. Son rêve c’était de voir Paris, du haut des escalators du Centre Pompidou. Quand il est arrivé au sommet, ce fut une immense émotion. Il voulait absolument parcourir la capitale à pied, c’était étonnant. Ce souvenir-là rivalise avec celui de la venue de Giuletta Masina, la même année. Nous présentions alors le cinéma de la province de Rimini, en Italie, d’où est originaire Federico Fellini. Giuletta Masina, qui était son ex-compagne, mais aussi la légendaire actrice de La Strada, était invitée pour l’ouverture. Les années étaient passées, mais on la retrouvait totalement, avec sa présence, son magnétisme, sa gouaille…
Je n’oublierai jamais l’agitation provoquée par Brian de Palma en 2002. Quelle surprise ! Des centaines de jeunes, qui n’avaient jamais mis les pieds à Beaubourg, étaient venus voir le réalisateur de Scarface.
Sylvie Pras
Je n’oublierai jamais l’agitation provoquée par Brian de Palma en 2002. Quelle surprise ! Des centaines de jeunes, qui n’avaient jamais mis les pieds à Beaubourg, étaient venus voir le réalisateur de Scarface, qu’ils portaient aux nues, qu’ils considéraient comme un artiste culte. La salle était bondée et nous étions complètement débordés. Brian de Palma ne pouvait plus sortir, c’était l’émeute. Nous étions coincés dans un sas minuscule. La police a dû intervenir ! Je ne me rendais pas compte que ce film avait touché tant de monde et j’étais ravie que tous ces jeunes se sentent légitimes de venir à Beaubourg.
En 2008, nous avons reçu Werner Herzog. Je connaissais ses films de fiction, moins ses documentaires, méconnus en France, et je n’étais pas forcément très à l’aise à l’idée de me retrouver face à celui qui avait affronté Klaus Kinski au fil de ces épopées dantesques. Contre toute attente, je l’ai trouvé absolument adorable, courtois… Là aussi, la réaction du public m’a surprise. Toutes les séances étaient complètes et certains spectateurs nous reprochaient de n'avoir pas programmé toute son œuvre en Grande salle.
Cette année, nous avons reçu la réalisatrice française Alice Diop, à l’occasion de la sortie de son film Nous. Elle est venue présenter ses productions et celles des metteurs en scène qui l’ont influencée ou qu’elle voulait dévoiler, j’ai eu le sentiment de rencontrer une grande artiste. Sa personnalité, son énergie, sa générosité et son désir de transmission m’ont particulièrement touchée. Je ne peux pas ne pas évoquer Michel Gondry, qui, en 2011, est venu installer son « usine de films amateurs ». Par groupe de quinze, les spectateurs de tout âge venaient réaliser un petit film dans un grand studio, « mi-hollywoodien, mi-bricolé », comme disait Michel, fabriqué pour l'occasion au Centre Pompidou ; une idée géniale. Et un plaisir de tous les instants. Il nous tenait à cœur d’aller chercher un public qui n’a pas l’habitude de ce type de manifestation : en Île-de-France, dans les foyers, dans les écoles déshéritées… Tout récemment, la cinéaste Kelly Reichardt a accompagné la rétrospective de ses films après deux ans d'attente dus à la pandémie. Elle aussi a fait preuve d'une belle générosité. L'année prochaine, en 2023, nous aurons Leos Carax, un véritable événement.
Quel doit être le rôle d’une institution comme le Centre Pompidou, à l’heure où le public déserte les salles de cinéma ?
Sylvie Pras — La situation est extrêmement difficile. Et peut-être que nous pouvons contribuer à trouver de nouvelles voies. Il y a le problème du prix des places. Comment voulez-vous résister, économiquement, en présentant un film à douze euros la place, quand en face, une plate-forme propose le même tarif, pendant un mois et pour toute la famille ? Au Centre Pompidou, les films sont gratuits pour les adhérent(e)s. Le plein tarif est à cinq euros et le tarif réduit à trois. L’enjeu, je le sais, n’est pas aisé pour tous les exploitants ; mais il faut réfléchir à la tarification. Ensuite, nous tâchons toujours de créer l'événement en invitant les cinéastes et en proposant systématiquement des présentations et des rencontres avec le public. Selon moi, le metteur en scène et ses comédiens, ses actrices, doivent accompagner leurs films. Ainsi, la salle se transforme en lieu de rencontre, de débat et d’échange… Là est peut-être la clef de la survie du cinéma d’auteur en salle. Jamais les plates-formes ne pourront rivaliser avec l’humain.
Jamais les plates-formes ne pourront rivaliser avec l’humain.
Sylvie Pras
Dans une enquête réalisée en mai 2022, le Centre national du cinéma et de l'image animée pointait aussi le manque d’intérêt du public pour les films, et les sujets traités. Est-ce aussi aux cinéastes de s’adapter à cette nouvelle donne ?
Sylvie Pras — Non, jamais. Ce n’est pas à l’artiste de s’adapter au marché. C'est plutôt le rôle de l’écosystème. Si Chantal Akerman, Werner Herzog, Takeshi Kitano ou Abbas Kiarostami avaient réfléchi ainsi, jamais ils n’auraient créé des œuvres aussi brillantes que les leurs. Certains iront vers les plates-formes. D’autres préféreront ne pas le faire, pour le grand écran, pour l’expérience collective et partagée… Mais une chose est sûre, il sera très difficile pour les films d'auteur d'être diffusés en salle, comme ils l'étaient, cinq fois par jour et sept jours sur sept. Ça, seuls les blockbusters pourront encore le faire. Pour tous les autres films, il faudra moins de séances, plus de rencontres, davantage de médiation… C’est l’avenir et déjà le présent au Centre Pompidou ! ◼