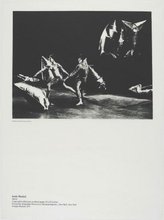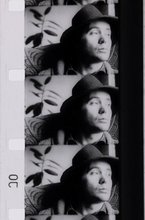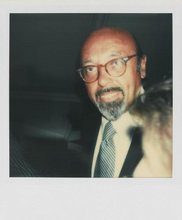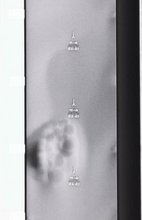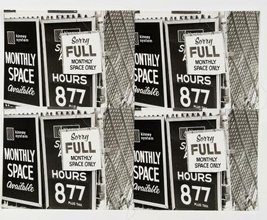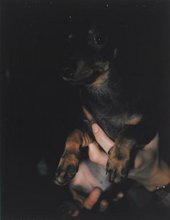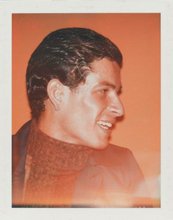Mao
1973

Mao
1973
| Ámbito | Dessin |
|---|---|
| Técnica | Mine graphite sur papier |
| Medidas | 92 x 92,5 cm |
| Adquisición | Achat de l'Etat, 1974. Attribution au Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle |
| Inventario | AM 1974-18 |
Información detallada
| Artista |
Andy Warhol (Andrew Warhola, dit)
(1928, États-Unis - 1987, États-Unis) |
|---|---|
| Título principal | Mao |
| Fecha de creación | 1973 |
| Ámbito | Dessin |
| Técnica | Mine graphite sur papier |
| Medidas | 92 x 92,5 cm |
| Inscripciones | Signé et daté au revers : Andy Warhol 73 |
| Adquisición | Achat de l'Etat, 1974. Attribution au Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle |
| Sector de colección | Cabinet d'art graphique |
| Inventario | AM 1974-18 |
Bibliografía
Lassalle (Hélène). - Art américain : oeuvres des collections du Musée national d''art moderne. - Paris : éd. du Centre Pompidou, 1981
(cit. et repr. p. 185)
. N° isbn 2-85850-107-6
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Poinsot (Jean-Marc).- "L''art contemporain et le musée : la fabrique de l''histoire ?", in Les Cahiers du Musée national d''art moderne, Hiver 1992, n°42 (cit. p.25) . N° issn 0181-1525-18
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Jonas Storsve, Guy Tosatto.- Au fil du trait : de Matisse à Basquiat : Collection du Centre Georges Pompidou : Musée national d’art moderne : Cabinet d’art graphique : Nîmes, Carré d''art, Musée d''art contemporain de Nîmes, 26 juin-27 septembre 1998.- éditions du Centre Pompidou, éditions du Musée d''art contemporain de Nîmes, 1998 (cit. et reprod. p. 35, cit. p. 158) . N° isbn 2-85850-960-3
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Collection Art graphique : [Catalogue de] La collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne - Centre de création industrielle. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2008 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle) (cit. et reprod. coul. p. 386) . N° isbn 978-2-84426-371-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Visages, Picasso, Magritte, Warhol : Marseille, Centre de la Vieille Charité, 21 Février - 22 Juin 2014.- Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 2014 (Cat. n° 17, cit. p. 195, reprod. coul. p. 62) . N° isbn 978-2-7118-6157-6
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Poinsot (Jean-Marc).- "L''art contemporain et le musée : la fabrique de l''histoire ?", in Les Cahiers du Musée national d''art moderne, Hiver 1992, n°42 (cit. p.25) . N° issn 0181-1525-18
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Jonas Storsve, Guy Tosatto.- Au fil du trait : de Matisse à Basquiat : Collection du Centre Georges Pompidou : Musée national d’art moderne : Cabinet d’art graphique : Nîmes, Carré d''art, Musée d''art contemporain de Nîmes, 26 juin-27 septembre 1998.- éditions du Centre Pompidou, éditions du Musée d''art contemporain de Nîmes, 1998 (cit. et reprod. p. 35, cit. p. 158) . N° isbn 2-85850-960-3
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Collection Art graphique : [Catalogue de] La collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne - Centre de création industrielle. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2008 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle) (cit. et reprod. coul. p. 386) . N° isbn 978-2-84426-371-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Visages, Picasso, Magritte, Warhol : Marseille, Centre de la Vieille Charité, 21 Février - 22 Juin 2014.- Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 2014 (Cat. n° 17, cit. p. 195, reprod. coul. p. 62) . N° isbn 978-2-7118-6157-6
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Ver más
Ver menos