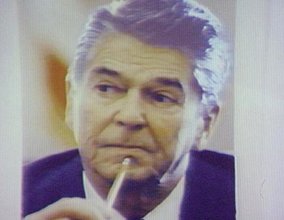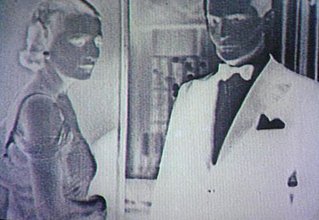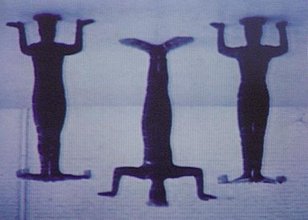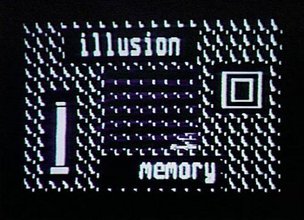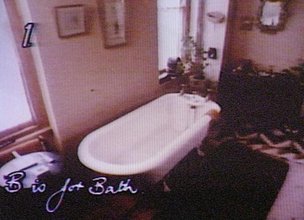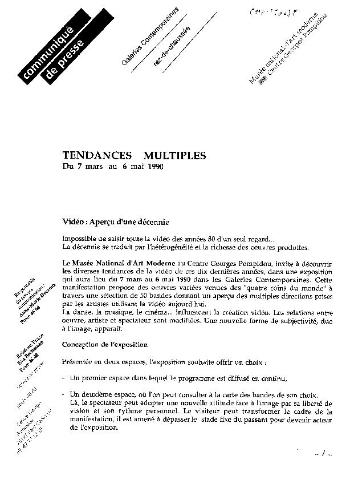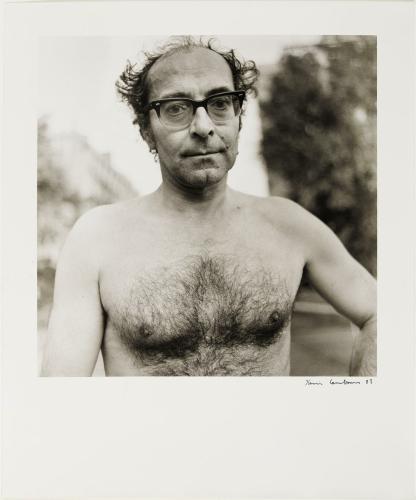Exposición
Tendances multiples
�7 mar - 13 may 1990
�7 mar - 13 may 1990

El evento ha terminado
Cette exposition est consacrée aux tendances de la vidéo des années 80.
Elle présente une sélection internationale d’une cinquantaine de bandes, donnant ainsi un aperçu des multiples directions prises par les artistes utilisant la vidéo aujourd’hui. En effet, la danse, la musique, le cinéma, la mode influencent aujourd’hui la création vidéo. Les relations entre œuvre, artiste et spectateur son modifiées. Une nouvelle forme de subjectivité, due à l’image, apparaît.
L’exposition se divise en deux espaces. Un premier espace dans lequel le programme est diffusé en continu. Un deuxième espace, où l’on peut consulter à la carte des bandes de son choix. Ici, le spectateur peut adopter une nouvelle attitude face à l’image par sa liberté de vision et son rythme personnel. Le visiteur peut ainsi transformer le cadre de la manifestation, il est amené à dépasser le stade fixe du passant pour devenir acteur de l’exposition.
Six moniteurs sont ainsi installés :
- l’un d’entre eux se trouve hors de l’exposition, près de l’entrée des Galeries contemporaines ;
- un second moniteur à l’intérieur de l’exposition annonce le programme en continu ;
- pour le programme continu, deux moniteurs sont installés ;
- deux autres moniteurs sont destinés au programme à la carte, à la disposition du public.
Parmi les 50 réalisations des vidéastes, citons les plus connus : Chantal Akerman, Marc Caro, Jean-Luc Godard, Jenny Holzer, Gary Hill, Thierry Kuntzell, David Larcher, Claude Mourieras, Jean-Louis Nyst, Nam June Paik, Shuji Terayama, Shintaro Tanikawa, Bill Viola, Les Vasulkas et Tamas Waliczky.
Flash-back sur l’Art vidéo
La première œuvre connue faisant appel à la vidéo, mais qui n’a jamais en fait été représentée, est de George Brecht. A la date du 25 juin 1959, dans son cahier de notes, on trouve l’ébauche d’une Television Piece, assemblage de neuf téléviseurs en marche, formant ce qu’on appellerait aujourd’hui un Mur Video.
Trois ans après le concept de Georges Brecht, durant l’été 1962, Nam June Paik, compositeur d’origine coréenne invité par le studio de musique expérimentale du Westdeutscher Rundfunk de Cologne, entreprend de faire des expériences avec des tubes cathodiques de téléviseur. Il manipule l’image des téléviseurs dans un geste où sont déjà mêlés le théâtre, le visuel et la musique. Ainsi peu après, du 11 au 20 mars 1963, Nam June Paik expose les résultats de ces premières recherches à Wüppertal , à la galerie Parnass, dans une exposition personnelle intitulée : « Exposition of Music-Electronic Television ».
Durant les années 70, l’art vidéo va rechercher sa spécificité tout en commençant à exploiter ses multiples possibilités.
Métamorphoses des années 80
Les années 80 accentuent la nouveauté et la diversité de l’Art vidéo. Les œuvres vidéo se manifestent ainsi, influencées par les diverses formes artistiques, dans :
- la danse, l’écriture des corps et les relations de l’image à la danse ;
- la musique et les affinités sons/images ;
- le cinéma ;
- le portrait de personnes anonymes ou célèbres ;
- la littérature, les rapports mots/images, elles se prêtent aussi aux échanges intimistes de type épistolaire ;
- le théâtre ;
- la peinture.
Toutes ces formes de création viennent se ressourcer à la vidéo, mais aussi l’enrichir, dans un mouvement de va et vient. Ces effets de miroir participent aussi à la réflexion de la vidéo sur elle-même.
L’exposition évoque également les nouvelles technologies (de la palette graphique à l’informatique) qui, en fusionnant, la conduisent vers de nouveaux horizons. L’image de synthèse pure résulte d’une démarche mathématique et annonce aussi une nouvelle problématique vidéo.
Le Musée national d’art moderne possède l’une des plus importantes collections de bandes et d’installations vidéo au monde. Il fut le troisième musée à constituer une collection vidéo après le Stedelijk Museum d’Amsterdam, qui compte environ 300 œuvres. Historiquement, la collection vidéo du Musée débuta en 1977. En treize ans, cette collection fut enrichie de 450 œuvres. Aujourd’hui, en 1989, elle en compte 500, au format 3/4 de pouce, provenant de tous pays.
L’un des projets pour présenter cette collection serait la création d’une vidéothèque à l’intérieur du Musée national d’art moderne. En France, rares sont les lieux qui accueillent la vidéo.
Les installations vidéo des collections du Musée (Dan Graham, Thierry Kuntzel, Bruce Nauman, Nam June Paik) sont exposées régulièrement dans les espaces des collections du Musée, lors d’expositions et sont prêtées à des institutions internationales et à des musées de province.
A ce jour, les Vidéos art sont le plus souvent présentées par thèmes ou tranches historiques à l’intérieur même des expositions. En 1986, une exposition dans les Galeries contemporaines présente une vaste sélection d’œuvres internationales, de 1965 à 1986. En 1987, à l’occasion de l’exposition L’époque, la mode, la morale, la passion, dix heures de programmation vidéo, représentant les diverses orientations des artistes de la décennie 77-87, furent montrées. Une sélection d’œuvres vidéo montrant les interactions entre vidéo et publicité est diffusée dans l’exposition Art et Publicité en 1990.
La manifestation Passages de l’Image prévue à l’automne 1990 (de septembre à novembre) dans les Galeries Contemporaines, présente les multiples approches de l’image contemporaine :
- correspondances entre photographie, cinéma, vidéo et quelques-unes des nouvelles technologies ;
- seize œuvres d’artistes sont montrées, dont 5 sont des commandes spéciales aux artistes pour l’exposition ;
- un programme de films et de vidéos sera diffusé dans la salle Garance.
Au final, il se révèle impossible de saisir toute l’histoire de la vidéo des années quatre-vingt d’un seul regard… La décennie se résume par l’hétérogénéité et la richesse des œuvres produites.
D’après le communiqué de presse
Dónde
Galeries contemporaines
Quando
�7 mar - 13 may 1990
todos los días excepto martes