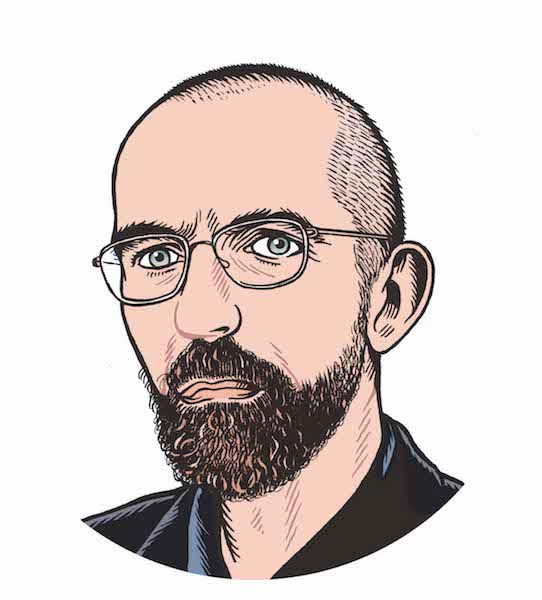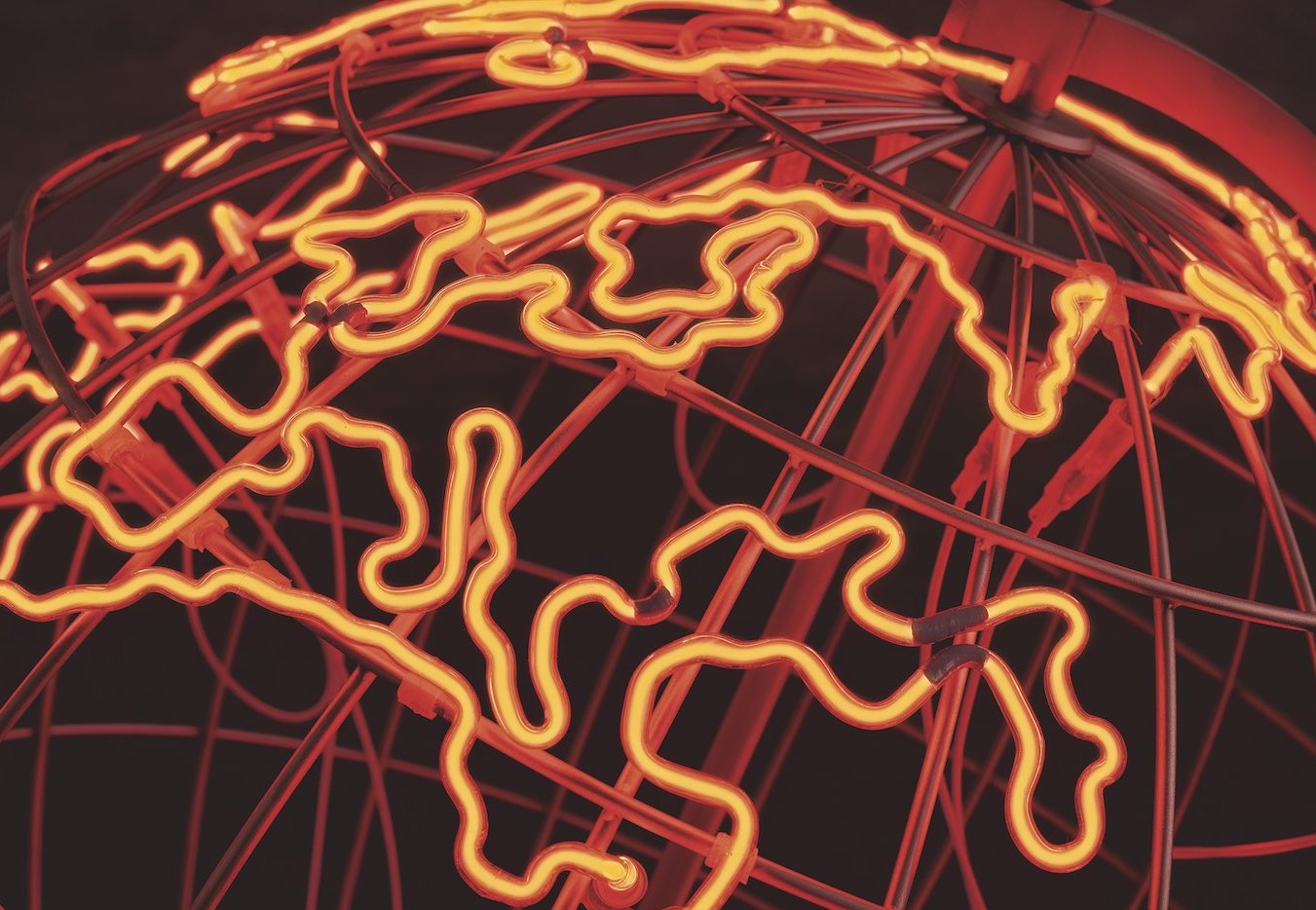
Dipesh Chakrabarty : « La planète ne nous renvoie pas notre regard. »
Certains chercheurs ne se contentent pas d’introduire dans leur champ d’expertise une rupture décisive, porteuse de nouveaux horizons : ils savent aussi s'éloigner de cette rupture même pour tourner une deuxième fois la page, et opérer dans la pensée comme une seconde révolution. Professeur distingué de l’université de Chicago, l’historien indien Dipesh Chakrabarty fut l’auteur en l’an 2000 de ce qui devait devenir l’un des essais phares des études post-coloniales : intitulé Provincialiser l’Europe, la pensée postcoloniale et la différence historique, l’ouvrage diagnostiquait les biais qu’induit le point de vue occidental dans l’écriture de l’histoire, tout en montrant comment, à déboîter le récit du monde de sa matrice européenne, on renouvelle profondément l’arsenal de l’historien.
Or voici qu’à l’automne 2019, paraît dans la revue Critical Inquiry un article saisissant : dans « La Planète : une catégorie humaniste émergente », Chakrabarty invite à un nouveau déplacement. Selon lui la globalisation, comme récit et comme processus centré sur l’unification du monde par et pour l’activité humaine, touche à sa fin ; le réchauffement climatique qu’elle engendre nous introduit à une tout autre perspective, celle du « planétaire ». Cela oblige l'humaniste à entrer dans un nouveau dialogue avec les sciences, l’historien à se situer dans une autre échelle de temps, le citoyen du monde à renouveler ses catégories éthiques et politiques.
Mathieu Potte-Bonneville – Votre trajectoire intellectuelle va des questions post-coloniales aux problèmes environnementaux dans le contexte de la post-mondialisation. Quel lien établissez-vous entre ces deux séries de réflexions ?
Dipesh Chakrabarty – Mon parcours est intrinsèquement lié à la mondialisation : mon intérêt pour les questions post-coloniales fait partie d’une histoire globale. Par exemple, l’Inde dans le contexte du 18e siècle était le dernier théâtre des conflits entre les Français et les Britanniques, qui s’affrontaient pour la domination d’un seul empire. Et ce sont les Français qui ont perdu. Lorsque l’historien britannique E.P.Thomson, séjournant en Inde, a constaté que le marxisme indien était le même que le marxisme anglais, l’un de mes amis a répliqué : « s’il en est ainsi, c’est que le général français qui a perdu l’empire d’Inde s'appelait Dupleix, et que le général anglais qui l’a gagné s’appelait Clive, ni plus ni moins. Si l’Inde était devenue un empire français, tout le monde aurait parlé de structuralisme... Vous nous avez gouvernés, donc nous parlons votre langue, mais cela n’a rien à voir avec la vision du monde qu’avaient les Français ».
Avec l’abolition de l’Empire, le temps était à l’opposition aux idées impérialistes, et c’est ce dont j’ai hérité de mes parents. Pendant mon enfance, au mitan des années 1960, les anciennes puissances coloniales comme les États-Unis, le Canada et l’Australie ont allégé leurs restrictions migratoires, ce qui a encouragé des gens de ma classe à migrer vers l'ouest. Bien entendu, l'émigration des classes ouvrières remonte à bien plus longtemps, et la présence d’Africains ou de Caribéens en Angleterre ou en France post-coloniale était établie, mais d’autres catégories professionnelles ont commencé à migrer et se sont heurtées à ce que je qualifierais de formes métropolitaines de racisme post-impérialistes. Finalement, l’Angleterre était bien moins raciste envers les Indiens lorsque l’Inde faisait partie de l’Empire...
Le post-colonialisme était, à certains égards, une réponse au racisme post-impérialiste ; mais en même temps, il s’inscrivait dans une dynamique de mondialisation. Si on y réfléchit, autour des années 2000, le gros de la classe moyenne consommatrice était composé d’Européens et d’Américains, de Nord-Américains. Aujourd’hui, ils ont fait place aux non-Européens et aux non-Américains, notamment des Chinois et des Indiens. Désormais, les Européens et les Américains constituent environ 35 % de la classe moyenne dans le monde. D’une certaine manière, ma réflexion sur la mondialisation a suivi le sens de l’histoire que nous voyions s’écrire devant nos yeux : toute ma vie, c’est une évidence, faisait partie de ce flux historique. C’est la post-mondialisation qui a constitué un accident majeur à mes yeux.
Ma réflexion sur la mondialisation a suivi le sens de l’histoire que nous voyions s’écrire sous nos yeux.
MPB – Justement, à quel moment est intervenu pour vous ce changement de perspective, qui vous amène aujourd’hui à interroger le « planétaire » plutôt que le « global » ?
DC – J'ai commencé à formuler ainsi les choses suite à une conversation avec une philosophe française, Catherine Malabou, qui me disait combien pour elle le globe de la globalisation et le globe du réchauffement climatique avaient deux significations différentes. Cela m’a aidé à clarifier beaucoup de questions que je me posais en réalité depuis longtemps. Lorsque je me suis rendu en Australie pour passer mon doctorat, et que j’y ai découvert les grands espaces et la nature australienne, l’année 2003 a été marquée par une sécheresse sans précédent et un grand incendie a éclaté à Canberra, la capitale. Il a détruit 3 300 maisons, tué près de 25 personnes ainsi que des millions d’animaux, et détruit tous les paysages que j’aimais. Je me suis donc demandé comment des feux aussi dévastateurs peuvent se produire, et mes amis australiens, des écologistes, m’ont expliqué que cette sécheresse n’était pas normale, qu’elle résultait du changement climatique. On était en 2003, alors j’ai demandé ce qu’était le changement climatique. Je n’en avais aucune idée, et j’ai été sidéré de lire que des scientifiques estimaient que les êtres humains avaient le pouvoir de repousser la prochaine ère glaciaire de plus de 50 000 ans. En tant qu’historien, je n’avais jamais pensé à appliquer cette échelle à l’être humain. J’étais avant tout un historien de l’expansion européenne, de la colonisation, sur une échelle de 500 ans. Et je me disais que ce qui avait trait à la planète relevait du domaine de la science et que je n’avais pas besoin de m’y intéresser.
Je compare parfois cette histoire avec le fait d’avoir du diabète, ce qui est le cas pour beaucoup d’Indiens. Votre médecin vous apprend du jour au lendemain que vous êtes diabétique ; il vous pose des questions, et voilà que votre histoire s’élargit... Le mien m’a d’abord expliqué qu’étant professeur, je ne faisais pas assez d’exercice, et que c’était normal ; mais il m’a ensuite demandé si mes parents avaient également du diabète, ce qui nous entraînait sur le terrain de la génétique, et questionné sur mon alimentation principale. Quand j’ai évoqué le riz, il a dit qu’effectivement, ceux qui se nourrissent de riz sont souvent diabétiques. Pendant combien de temps avez-vous suivi ce régime ? Je me suis dit : pendant 5 000 ans... D’un coup, mon histoire ne se limitait plus aux 500 dernières années ; elle enveloppait l’histoire de l’agriculture.
MPB – Dans la distinction que vous proposez entre le « global » ou « mondial », et le « planétaire », vous soulignez combien le concept d’histoire mondialisée vous semble lié à une perspective limitée, celle de l’Europe. En quoi parler de mondialisation est-il européocentriste ?
DC – Parce que cela émane d’un processus que Heidegger appelait « l’européanisation de la Terre ». Cette conceptualisation géographique et politique naît à l’ère moderne, alors que les Européens s’aventurent plus loin et approfondissent leur connaissance des océans pour construire leurs empires. La découverte des océans et l’aptitude à les traverser ont représenté des enjeux déterminants. Vous ne pouvez pas séparer ce qu’on a appelé « la Terre » de l’expansion européenne et du commerce, avec leurs effets sur la cartographie et sur le développement des instruments de navigation. Une autre distinction très importante entre ce que la modernité appelait le globe et ce que j’appelle la planète, tient au fait que le globe pouvait apparaître comme un objet accessible à notre perception : même le télescope était un moyen d’étendre les capacités de nos organes naturels, là où ce que les scientifiques nomment aujourd’hui « planète » est d’abord l’objet d’une reconstitution mentale, intellectuelle.
Ce que les scientifiques nomment aujourd’hui « planète » est d’abord l’objet d’une reconstitution mentale.
MPB – Pour autant, vous y insistez : même si l’image de la planète, telle qu’elle émerge aujourd’hui des ESS (Earth System Sciences, sciences du système-Terre) est un agrégat de données scientifiques très abstraites, elle fait l’objet d’une forme d’inquiétude existentielle. La modernité nous avait pourtant habitués à distinguer la science objective du registre de nos émotions...
DC – En effet, j’ai souvent été frappé de voir combien les scientifiques qui travaillent sur le système terrestre ont des dispositions émotionnelles envers leur objet. Même si ce n’est pas quelque chose que l’on perçoit de nos propres yeux, cet objet nous affecte, et quand des scientifiques soulèvent des questions comme : peut-on gouverner cette planète ? Peut-on la contrôler ? Peut-on devenir les régisseurs du système planétaire ? Peut-il y avoir une Anthropocène positive ? Toutes ces questions émanent d’interrogations existentielles : que se passerait-il si nous n’étions pas capables de toutes ces choses ? Tout en reconstituant la planète dans leur esprit, comme une entité abstraite, ils répondent à cette question dans les termes existentiels les plus humains. Au fond, mon point de départ pour répondre à la question : « comment la planète devient-elle une catégorie de la pensée humaniste ? », c'est la situation à laquelle sont confrontés les scientifiques, la manière dont ils font l’expérience d’un objet dont on ne peut faire l’expérience.
MPB – Le tableau que vous donnez des sciences du système-Terre complique ce que nous appelons d'ordinaire la « conscience écologique ». Par exemple, là où celle-ci insiste sur le caractère unique de notre monde, sur le fait qu’il « n’y a pas de planète B », vous soulignez combien pour les scientifiques comprendre notre planète suppose de la comparer à d’autres, réelles ou possibles...
DC – C’est l’un des aspects fascinants de la science planétaire contemporaine. Par exemple, le réchauffement planétaire : une fois que vous connaissez l’effet du dioxyde de carbone, vous pouvez expliquer pourquoi Mars est froide et Vénus est chaude, n’est-ce-pas ? C’est comparatif en ce sens. Comprendre notre monde, y compris dans ce qu’il a de singulier, implique de le rapprocher d’autres configurations planétaires. Même la question : « Qu’est ce qui rend une planète habitable ? » est intrinsèquement comparative ; même si nous n’avons pas d’autre planète habitable à étudier pour l’instant, nous pouvons imaginer que s’il y avait de la vie sur une autre planète, certaines lois s’appliqueraient, comme celle de la sélection naturelle, etc. Cela vient déplacer le point de vue selon lequel l’action humaine devrait être au centre de la réflexion et constituer l’unique point de référence pour penser les processus qui concernent notre globe. En même temps, ne perdons pas non plus de vue le fait qu’aujourd’hui même, plusieurs conceptualisations du planétaire s’affrontent : comme disait Bruno Latour, non seulement au cours du temps les hommes ont imaginé la planète de différentes manières, mais de nos jours, l’idée qu’Elon Musk se fait de la planète, ou celle de Trump, ne sont pas celles des scientifiques du système-Terre...
Aujourd’hui même, plusieurs conceptualisations du planétaire s’affrontent.
MPB – Vous soulignez que penser la planète implique de se détacher d’une forme de face-à-face qui marquait notre conception traditionnelle du monde. Je vous cite : « Rencontrer la planète, c'est rencontrer quelque chose qui est la condition de l'existence humaine et qui demeure cependant profondément indifférent à cette existence ». Dans cette confrontation avec l’inhumain, on retrouve presque des échos du fatum des anciens...
DC – Contrairement à ce qu’enseignent la plupart des doctrines religieuses, le christianisme, l’islam, le judaïsme, voire l'hindouisme, qui vous font vous sentir spécial, on pourrait dire que la planète ne nous renvoie pas notre regard. Dans la conception de Heidegger, lorsque vous vous approchez d’un arbre, c’est comme si la Terre faisait monter la sève dans l’arbre pour vous accueillir avec un fruit. Bien sûr, il ajoute que notre relation avec la Terre repose sur le conflit parce que pour l’habiter, nous voulons être en sécurité, sans jamais l’être à cause du tonnerre, des animaux, de la pluie, et j’en passe. Mais il souligne aussitôt que, s’il y a bien conflit, il y a mutualité. À l’inverse, faire l’expérience de la planète, c’est faire une expérience complètement non-mutuelle. Cela rappelle davantage certaines spiritualités antiques, et vous avez raison : je me suis toujours dit que mon travail découlait probablement du stoïcisme. À mon sens, la planétarité est si inhumainement vaste, dans toutes ses dimensions, que nous dépendons d’elle, que nous sommes à sa merci, et cela nous désoriente. C’est aussi ce qui m’éloigne du point de vue selon lequel il suffirait de renverser le capitalisme pour résoudre le problème : face à une telle crise, certains problèmes peuvent être résolus, dans une échelle de temps humaine et par des institutions humaines, mais certains sont trop vastes pour qu’on y apporte une réponse. Pour y penser clairement, il vous faut des ressources stoïques.
MPB – Cela veut-il dire que, d’un point de vue politique, l’horizon planétaire est hors de portée ? En quel sens nos concepts politiques sont-ils pour vous liés à la perspective globale ?
DC – Sur ce point, j’avoue avoir été influencé par la lecture que propose Heidegger de l’allégorie de la caverne de Platon. Il insiste, vous le savez, sur la distinction entre la lumière du soleil et les réalités que celle-ci donne à voir : lorsque le prisonnier s’échappe de la caverne, il discerne des arbres, des oiseaux, des montagnes, et chacune de ces réalités est une forme ; mais si la lumière permet de distinguer ces formes, elle n’a pas elle-même de forme et ne peut donc être perçue directement. De même, lorsqu’on se pose des questions telles que « l’Inde est-elle un pays plus démocratique que la Chine ? », ou « l’Inde devient-elle autoritaire ? », ou lorsqu’on affirme qu’il devrait y avoir une justice climatique, on ne peut le faire qu’en mobilisant des concepts formels, et ces formes dépendent d’une certaine façon de l’horizon global. C’est à l’intérieur de cette sphère que nous réfléchissons, que nos impératifs prennent naissance.
Mais la planète, de son côté, est un objet qui échappe à toute saisie globale : nous lui imputons certaines propriétés, comme les courants océaniques ou les mouvements des plaques tectoniques, nous l'imaginons par fragments, tels les croquis dans les manuels de géologie, des modèles, mais elle demeure à l’arrière-plan. Ainsi, la planète est un peu comme la lumière, dans la lecture heideggerienne de l’allégorie de la caverne. C’est la condition informelle des formes. Et c’est aussi pourquoi elle résiste à la politisation. Rien dans l’histoire de la planète ne permet de fonder nos impératifs politiques. Prenez la biodiversité : c’est une question qui, en un sens, n’intéresse que les êtres humains, puisqu’ils sont les produits de cette biodiversité, de cette forme de vie multicellulaire. Mais la vie multicellulaire est apparue il y a à peine 500 millions d’années, quand la Terre a plus de quatre milliards d’années : rien ne l’oblige à être habitable ! Cette planète aurait pu être semblable à toute autre planète tellurique, sans vie.
MPB – Diriez-vous alors que dans ce nouveau contexte, notre tâche est d’inventer de nouvelles formes pour traiter des enjeux politiques présents ? Ou plutôt de trouver des manières non-formelles de penser et de créer, pour nous porter à la hauteur de la planète elle-même ?
DC – Dans le dernier chapitre du livre que je viens de terminer, je tente de répondre à la question : « Que pensez-vous, où vous positionnez-vous, lorsque vous admettez que la planète n'est pas vis-à-vis de nous dans une relation de mutualité ? ». D’abord, soyons clairs : d’un point de vue existentiel, les humains doivent faire quelque chose. Cette planète doit être notre préoccupation. Il n’y a pas d’alternative à l’activisme, pas d’alternative au fait de réagir. Mais cela passe en partie par le fait d’accepter que les êtres humains n'ont rien de spécial, qu’ils n'ont pas à revendiquer la biosphère. Le fait est que les religions axiales, toutes les religions inventées depuis l’érection des villes, il y a environ 5 000 ans, font le postulat que l’être humain est spécial. Mais si vous vous intéressez aux religions indigènes, celles des Aborigènes d’Australie, des Africains, des tribus indiennes, des Amérindiens étudiées par Eduardo Viveiros de Castro, vous réalisez qu’elles sont toutes liées aux autres formes de vie, et même aux éléments non-vivants comme les rivières et les montagnes, et qu’elles ne font pas des humains des êtres spéciaux.
Les humains sont une forme de vie minoritaire... qui crée une crise de la biodiversité.
J’entends bien que nous sommes confrontés à une urgence : nous sommes 7,5 milliards sur Terre grâce à la civilisation industrielle, aux énergies fossiles ; nous serons bientôt 9 milliards. Nous avons connu une croissance très rapide : en 1900, nous étions 1 milliard. Donc la question se pose de savoir comment adapter à une telle densité de population les systèmes sociaux d’antan, faits pour supporter un nombre limité d'habitants. Pour autant, notre forme de vie ne cesse pas d’être minoritaire : la pandémie actuelle ne fait que le rappeler, la proportion dominante de vie sur Terre est microbienne. Les microbes l’emportent largement sur les animaux, et au sein des animaux les humains sont une forme de vie minoritaire... et c’est cette forme de vie qui domine l’ordre des choses et crée une crise de la biodiversité.
Du coup, je pense que nous devrions nous inspirer des formes de pensée minoritaires. Et je ne parle pas seulement des indigènes, mais des groupes qui ont historiquement vécu en tant que minorités et développé une pensée qui n’était plus régie par le désir de dominer. Il faut s’intéresser aux perdants, à Kafka, à la littérature mineure... Que ce soit au début de l’ère moderne ou même au début de l’ère mondialisée, de petits groupes de marchands, juifs, arméniens, indiens, vivaient dans les villes portuaires, sur la côte africaine. D’ailleurs, lorsque Gandhi s’est rendu en Afrique du Sud, il est allé à la rencontre de ces groupes minoritaires. Il a fondé son Ashram dans lequel sont venus vivre des gens du monde entier. Si vous lisez Gandhi à ses débuts, vous comprendrez ce qui constitue pour moi une forme de pensée minoritaire.
MPB – Vous appeliez il y a vingt ans à « provincialiser l’Europe » pour la replacer sur le fond d’une histoire globale. Tout se passe comme si, désormais, vous invitiez à provincialiser la globalisation elle-même, et à repenser l’humanisme sur le fond d’un horizon planétaire bien plus vaste, dont nous dépendons sans pouvoir prétendre en constituer le centre...
DC – Prenons un exemple : l’air que nous respirons est une condition essentielle de notre existence individuelle et collective, de même que pour les plantes et les animaux. Et si l’on fait l’histoire de cette condition, l’histoire de nos poumons, on s’aperçoit que la biodiversité a maintenu l’atmosphère à un niveau qui a évité que les forêts ne partent en fumée, ou que nous nous soyons étouffés, et ce pendant 400 millions d’années. C’est ce que les scientifiques du système terrestre appellent « l’atmosphère moderne » de la planète – une modernité qui n’a rien d’intrinsèquement humain, même si nous en avons été les bénéficiaires. Au passage, cela me fait sourire d'entendre les historiens parler du monde moderne en évoquant la Renaissance ou le siècle des Lumières, alors que pour les scientifiques qui s’intéressent au système terrestre, cette période s’étend sur 400 millions d’années. C’est ce changement de perspective qui m’intéresse : nous devons donc trouver un mode de vie qui part du principe que nous ne sommes pas au centre des choses, que nous sommes une forme de vie minoritaire et que nous dépendons des formes de vies qui nous entourent. La modernité au sens des historiens, qui a inventé le capitalisme, dépend d’une modernité non-humaine, en lien avec l’équilibre du vivant. Et dans un sens très profond, je dirais que le capitalisme moderne s’oppose à la vie. ◼
Planétarium, cartographies contemporaines
Urgence climatique, nouveaux équilibres internationaux, hausse des migrations, transition numérique : les quatre transformations majeures qui caractérisent notre temps ont en commun de bouleverser l’espace dans lequel se déploient l’action et la vie humaines. Dans un monde où l’ensemble des repères dont nous disposions se trouve ébranlé, l’art et la pensée contemporaine peuvent-ils aider à s’orienter ? Afin de contribuer à dresser une autre image du monde, le cycle Planétarium propose d’articuler deux séries d’enquêtes : d’une part un panorama des instruments, tant techniques (de la cartographie à la géolocalisation) que conceptuels (que deviennent le couple local-global ? Qu’appelle-t-on encore une frontière ?). D’autre part, un inventaire des attachements, ces inscriptions géographiques dont dépend concrètement l’exercice de la pensée et de la création.
Pour chaque séance, Planétarium convie ses invités du monde des sciences, des sciences humaines et de l’art, à prendre appui sur un lieu (autrement dit, à introduire systématiquement leur propos par la désignation et la description d’un espace réel ou fictionnel où leur paraissent se concentrer certains enjeux de notre temps), complétant ainsi de séance en séance une cartographie fragmentaire des sites successivement explorés. Accompagnés en direct par le dessinateur Éric Valette, qui esquisse l’atlas de ces lieux de pensée. Le cycle se déploie non seulement au travers d’une série de sessions au Cinéma 1 du Centre Pompidou, mais aussi au travers de contributions publiées chaque mois dans le quotidien d’idées AOC.media.
Un cycle de rencontres proposé par le Centre Pompidou et la fondation Mao Jihong
Related articles
Mona Hatoum, Hot Spot (stand), 2018
Stainless steel and neon tube, 172 × 83 × 80 cm (détail)
© Mona Hatoum
Photo © White Cube (Photo: Ollie Hammick)
Illustration © Stéphane Trapier