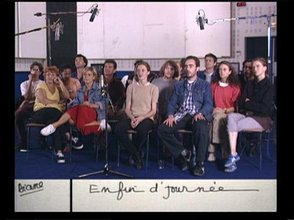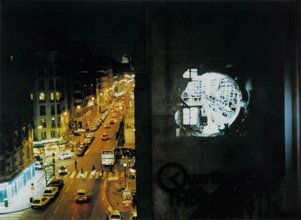This is not a time for dreaming
2004

This is not a time for dreaming
2004
| Domain | Oeuvre en 3 dimensions | Installation audiovisuelle |
|---|---|
| Techniques | Installation audiovisuelle 1 vidéoprojecteur, 2 haut-parleurs, 1 film 16 mm transféré sur D5 NTSC, 16/9, 24', couleur son stéréo surrounding, 1 affiche, 1 livret |
| Dimensions | dimensions de la salle : 1100 x 650 cm projection de 366 x 224 cm |
| Acquisition | Don de Société des Amis du Musée national d'art moderne, 2006 |
| Inventory no. | AM 2006-57 |
Detailed description
| Artist |
Pierre Huyghe
(1962, France) |
|---|---|
| Main title | This is not a time for dreaming |
| Creation date | 2004 |
| Domain | Oeuvre en 3 dimensions | Installation audiovisuelle |
| Techniques | Installation audiovisuelle 1 vidéoprojecteur, 2 haut-parleurs, 1 film 16 mm transféré sur D5 NTSC, 16/9, 24', couleur son stéréo surrounding, 1 affiche, 1 livret |
| Dimensions | dimensions de la salle : 1100 x 650 cm projection de 366 x 224 cm |
| Printing | 1/6 + 2e.a. |
| Acquisition | Don de Société des Amis du Musée national d'art moderne, 2006 |
| Collection area | Nouveaux medias |
| Inventory no. | AM 2006-57 |
Analysis
Le spectacle se donne toujours chez Pierre Huyghe pour ce qu’il est : un territoire de représentation et de célébration, un horizon infiniment humain, dont l’artiste utilise tour à tour toutes les modalités d’expression (cinéma, théâtre, télévision). Entre La Toison d’or (1993), Blanche-Neige Lucie (1997) et Streamside Day Follies (2003), on peut voir son œuvre comme une opération d’exploration et de réhabilitation de récits perdus ou volés. À travers la fiction, l’exposition, l’architecture, le travail de Huyghe agit sur les relations que la culture contemporaine entretient avec son environnement et remet en circulation ce que l’histoire officielle n’a pu retenir. Depuis longtemps déjà, les pièces de Huyghe portaient en elles la promesse d’un mouvement vers le théâtre et la comédie musicale. This is not a time for dreaming , œuvre construite à partir de deux histoires parallèles enchâssées, incarne ce passage. La première est celle de Le Corbusier, à qui la Harvard University commande en 1965 un bâtiment, le Carpenter Center for the Visual Arts, projet qui fut l’objet de négociations complexes et qui s’inscrivait dans une transposition optimiste, voire utopique du monde naturel dans le monde bâti. La seconde est celle, quarante ans plus tard, de cette même institution qui propose à Huyghe de créer une pièce multidisciplinaire autour des enjeux de la vision de Le Corbusier. À partir d’un spectacle de marionnettes, qui inclut les acteurs des deux histoires, l’artiste retrace la généalogie du bâtiment et celle de son propre projet, où se rejouent les projections et les tensions entre les différents protagonistes. Marqué par la lenteur mélancolique des grands films musicaux américains (la bande-son est composée à partir de morceaux de Xenakis et de Varèse), ce film moderniste établit des correspondances et des résonances entre le lieu, le travail conceptuel de l’architecte et la démarche créatrice de l’artiste.
Stéphanie Moisdon
Source :
Extrait du catalogue Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne , sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007