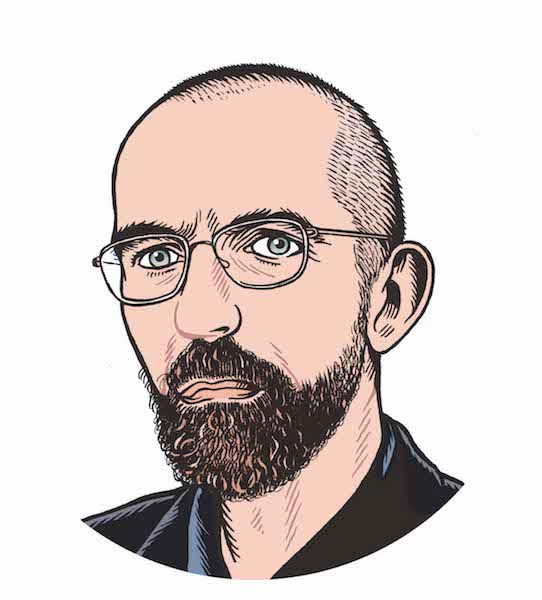Native Maqari et Simon Rouby : créer dans un espace entre sacré et profane
C’était à l’été 2020, dans la Grande Halle de la Villette avec laquelle le Centre Pompidou avait imaginé l’exposition collective « Les moyens du bord (du périphérique) ». Projetée sur le mur du fond, une immense silhouette armée d’un lave-pont s’appliquait à badigeonner de noir le tribunal de grande instance de Bobigny, dans une performance intitulée Blackout qui, du même geste faisait apparaître les travailleurs invisibles et disparaître un lieu de pouvoir. Un an plus tard, les artistes Simon Rouby et Native Maqari investissent un autre espace, celui de la Grande salle du Centre Pompidou, pour une soirée intitulée « Almajir ». Conviant le public sur le plateau lui-même, ils y recréent la cour de l’Albarkawa, maison de famille de Native Maqari construite à l’origine par le 43e Vizir de Zaria, et y rassemblent de nombreux artistes parmi lesquels le chorégraphe Qudus Onikeku et le musicien Keziah Jones, également invités dans le cours de cette programmation estivale. D’un été l’autre, d’un pays l’autre, nous avons conversé autour de cette expérience artistique hors-normes, entre résidence et performance, entre rituel et installation.
Mathieu Potte-Bonneville — Pouvez-vous retracer les origines de ce projet ?
Simon Rouby — Au départ, il y a une forme d’invitation rendue : Native était venu chez moi, dans le sud de la France, mais je n’étais jamais venu le voir à Zaria, dans le nord du Nigeria. Nous avons alors initié une sorte de résidence auto-organisée, avec l’envie de passer du temps là-bas et d’y travailler. Pour ma part, j’ignorais quelle forme cela pourrait prendre – Native, lui, savait un peu plus ce qui nous attendait : l’idée était de rouvrir la maison familiale située dans la vieille ville, qui n’est plus habitée depuis plusieurs décennies, et d’y engager un travail. C’est le lieu, cette cour de maison traditionnelle, qui a guidé et catalysé notre démarche : à chaque fois que nous nous y rendions, il se passait quelque chose, avec nous mais aussi avec les autres artistes que nous y avions invités, Keziah Jones, Qudus Onikeku, ou Bukunmi Olukitibi, qui danse dans le spectacle.
Native Maqari — L’enjeu, en effet, c’était de créer dans cet espace : d’être à Zaria, dans cet endroit précisément. L’idée de transcrire cette énergie, de la transposer et de l’exporter dans des espaces différents est venue par la suite. Travailler in situ est important pour nous, c’était déjà le cas pour Blackout que nous avons réalisé chaque fois dans un site précis. La différence, dans le cas d’Almajir, c’est que cette ancienne cour est très difficile d’accès : nous ne pouvions pas vraiment y accueillir du public, d’où l’idée de la faire voyager. Mais du coup, il s’est aussi agi de déplacer la périphérie vers le centre, d’emporter avec nous l’énergie qui circulait dans cette cour, de la faire ressortir dans les endroits que nous traversons ou fréquentons. Cela me fait songer à ce qu’écrivait l’artiste Jirō Yoshihara dans le manifeste du mouvement Gutai (mouvement d'avant-garde japonais d'après-guerre, ndlr) : « L’art est un lieu où quelque chose se passe. » Almajir, c’était cela, cette cour était un espace où quelque chose se passait, et il s’agit de convier le public à rejoindre un lieu où quelque chose advient.
Cela me fait songer à ce qu’écrivait l’artiste Jirō Yoshihara dans le manifeste du mouvement Gutai (mouvement d'avant-garde japonais d'après-guerre, ndlr) : « L’art est un lieu où quelque chose se passe. » Almajir, c’était cela, cette cour était un espace où quelque chose se passait, et il s’agit de convier le public à rejoindre un lieu où quelque chose advient.
Native Maqari
Mathieu Potte-Bonneville — Dans Blackout il s’agissait déjà d’investir et de transformer un lieu avec toutefois un propos essentiellement critique, faisant apparaître une mémoire des corps qui disparaît d’habitude des monuments officiels. Avec Almajir, il s’agit plutôt d’ouvrir un espace de manière créative, et de le convoquer sur le plateau. Pourquoi cet intérêt pour l’ouverture et la transformation des espaces ?
Native Maqari — Je pense que cela tient à la manière dont nous nous sommes rencontrés, dont nous avons commencé à travailler ensemble. Nous participions tous deux à un collectif baptisé Underground 1984 dont le but est justement d’ouvrir des espaces inaccessibles : avec Simon, nous avons donc ouvert beaucoup de portes fermées de toutes sortes, et de multiples façons…
Simon Rouby — Cela nous a toujours passionnés : ouvrir un terrain vague, entrer dans un immeuble abandonné ou dans un dépôt de train ou de métro… Ce geste, nous l’avons retrouvé en ouvrant la cour de l’Albarkawa, en récupérant ce gros trousseau de clefs et en commençant à ouvrir toutes les portes, avec des envies d’exploration. Ce qu’il y a de spécifique dans ce projet, c’est sans doute que nous n’avons pas cherché à articuler cette démarche dans un discours : là où le propos de Blackout était assez clair, l’enjeu cette fois était de s’installer dans cet espace, de voir ce qu’il déclenche et d’inviter ensuite les spectateurs à vivre la même expérience.
Mathieu Potte-Bonneville — Diriez-vous que vous avez cherché à défaire les assignations géographiques, en transportant ainsi un morceau de Nigeria sur le plateau du Centre Pompidou ? Après tout, vous jouez souvent avec la géographie : le projet que vous avez imaginé pour la Villa Kujoyama à Kyoto partait sur la figure semi-légendaire d’un « samouraï noir » pour imaginer une forme de porosité entre le Japon et le Sahel…
Native Maqari — Oui, d’ailleurs Simon adore dessiner de nouvelles cartes, refaire des frontières ou effacer des frontières qui existent ! Mais pour ce spectacle, il s’agit aussi de convoquer ou de ressusciter une forme de mémoire corporelle. J’ai grandi dans cette cour, et une part de mon éducation s’est faite en observant ce qui s’y passait. Chaque lieu est unique, et cette maison qui abritait des éducateurs et des intellectuels était un lieu d’apprentissage, où les gens venaient chercher des connaissances et les emportaient avec eux. C’est ce mouvement de partage de la connaissance que nous cherchons à retrouver. Cela implique en effet de faire un autre usage de la scène, en défaisant le dispositif traditionnel et frontal du théâtre pour y installer un tout autre genre d’espace, dans un dispositif pour lequel le mot même de spectacle ne convient pas très bien.
Pour Almajir, il s’agit aussi de convoquer ou de ressusciter une forme de mémoire corporelle. J’ai grandi dans cette cour, et une part de mon éducation s’est faite en observant ce qui s’y passait. Chaque lieu est unique.
Native Maqari
Simon Rouby — Cette cour, c’est aussi un lieu protecteur. Il faut mesurer ce qu’implique le fait de replier ainsi la carte en deux, d’inviter les spectateurs à se retrouver « là-bas » : nous avons choisi de faire de Zaria, et de cette maison précisément, l’épicentre du Sahel ou de notre idée du Sahel, que nous voyons comme un pays horizontal qui traverserait l’Afrique en largeur sous cette latitude, connectant les espaces les uns avec les autres du Sénégal à l’Afrique de l’Est. Mais concentrer dans ce point unique nos expériences étalées sur plusieurs pays et plusieurs dizaines d’années supposait de se donner un refuge, entre ces murs, pour y faire des choses qui ne seraient pas forcément comprises ou perçues dans un espace ouvert.
Mathieu Potte-Bonneville — Parmi les déplacements qu’Amajir opère, il y a non seulement la transposition géographique ou cette façon de recueillir l’espace entre les murs d’un refuge, mais aussi une manière de faire du processus de création l’objet de la création elle-même. À ce propos, quelle est la part d’improvisation ou d’expérimentation qui s’effectue sur le plateau, au moment même de la représentation ?
Simon Rouby — Étrangement, Almajir est un spectacle qui gagnerait à ne pas être beaucoup répété, à ne pas être calé trop précisément. Je le vois plutôt comme une sorte d’arborescence, qui se déploie sur le vif à partir du sol de la cour. En général, nous faisions entrer les artistes sans forcément leur expliquer ce dont il s’agissait, ou sans attendre quoi que ce soit de précis de leur part : je me bornais à les filmer, ou bien nous tâchions de nous souvenir de ce qui arrivait pour le refaire. C’est pourquoi, à chaque fois que nous avons réédité cette performance, nous avons essayé de ne pas la refaire à l’identique, en convainquant par exemple des artistes qui n’avaient pas pu nous rejoindre au Nigeria, comme Smaïl Kanouté ou Dramane Dembélé.
Nous avons choisi de faire de Zaria, et de cette maison précisément, l’épicentre du Sahel ou de notre idée du Sahel, que nous voyons comme un pays horizontal qui traverserait l’Afrique en largeur sous cette latitude, connectant les espaces les uns avec les autres du Sénégal à l’Afrique de l’Est.
Simon Rouby
Native Maqari — L’essentiel, en effet, c’est de préserver et de donner à voir ce processus de création. Pour autant, certaines thématiques apparaissent, que nous préférons évoquer plutôt que de les souligner explicitement. Par exemple, cette idée que la création implique une forme de médiation entre sacré et profane. C’est une question au cœur de l’expérience sahélienne. À l'origine, cette culture est très animiste, puis elle s’est islamisée en grande partie au travers du soufisme dont la dimension animiste demeure très forte, et que l'on retrouve partout, en Indonésie, en Turquie, en Algérie, au Nigeria… Le soufisme, indissociable de la musique et des spectacles, semble parfois s’opposer diamétralement au prophète et au divin. En réalité, ces deux dimensions ne sont pas opposées chez les gens, et participent d’une joie commune : par exemple, dans Almajir, chez cette femme qui prie et danse en même temps, qui colore une prière avec sa danse, qui boit ce qui normalement devrait être sa prière mais à laquelle nous avons substitué des noms d’êtres humains qui furent bien vivants et ont disparu. Rien ne parle davantage de l’humanité que sa fin. Là où selon le rituel, on boit les « 99 noms d’Allah », ou bien on les écrit sur une tablette, nous avons mis des statistiques. Des thématiques de ce genre se croisent, sans d’ailleurs le souci de les organiser chronologiquement : dans une cour, se succèdent une femme qui nettoie le sol, qui cuisine ou emballe son vêtement, et une heure plus tard un grand cérémonial aristocratique. Des vies qui n’ont rien à voir les unes avec les autres se croisent. Pour nous, il était important à la fois de témoigner de ce qu’il peut y avoir de spiritualité dans l’expérience au Sahel, et de ne pas considérer la scène, ou le théâtre, comme un espace sacré, réservé.
Des vies qui n’ont rien à voir les unes avec les autres se croisent. Pour nous, il était important à la fois de témoigner de ce qu’il peut y avoir de spiritualité dans l’expérience au Sahel, et de ne pas considérer la scène, ou le théâtre, comme un espace sacré, réservé.
Native Maqari
Mathieu Potte-Bonneville —Diriez-vous qu’Almajir est à la fois un rituel, et le contraire d’un rituel ?
Native Maqari — C’est aussi une manière de se placer au milieu, vis-à-vis de la façon dont l’art est considéré au Sahel et en Occident : là-bas, l’art a toujours été partie intégrante de la spiritualité, lié à des objectifs précis, si l’on danse, c’est pour faire venir la pluie, quand en Occident, l’art a acquis la liberté de s’exercer pour lui-même. Il s’agit de rechercher une forme de juste milieu. ◼
À lire aussi
Dans l'agenda
Portrait de Native Maqari et Simon Rouby
Photo © Nahd Hamza