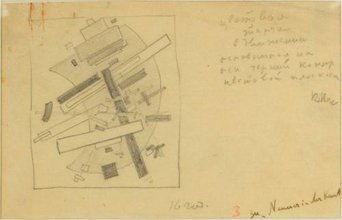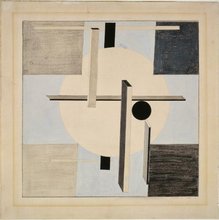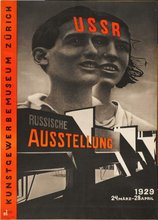Glissade (amorce)
[1919 - 1920]

Glissade (amorce)
[1919 - 1920]
| Domaine | Dessin |
|---|---|
| Technique | Mine graphite et gouache sur papier vergé filigrané |
| Dimensions | 9 x 22,6 cm |
| Acquisition | Achat, 1978 |
| N° d'inventaire | AM 1978-27 |
Informations détaillées
| Artiste |
El Lissitzky (Eliazar Lissitzky, dit)
(1890, Empire Russe - 1941, URSS) |
|---|---|
| Titre principal | Glissade (amorce) |
| Ancien titre | Etude pour un proun |
| Date de création | [1919 - 1920] |
| Domaine | Dessin |
| Technique | Mine graphite et gouache sur papier vergé filigrané |
| Dimensions | 9 x 22,6 cm |
| Inscriptions | Non signé, non daté. En bas à gauche : SKOL'ZHNIE (NASTUPLENIE) [Glissade (amorce)] |
| Acquisition | Achat, 1978 |
| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |
| N° d'inventaire | AM 1978-27 |
Bibliographie
Collection Art graphique : [Catalogue de] La collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne - Centre de création industrielle. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2008 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle)
(cit. et reprod. coul. p. 130-131)
. N° isbn 978-2-84426-371-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Lire la suite
Voir moins