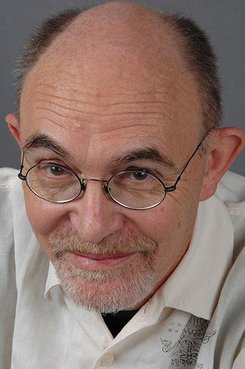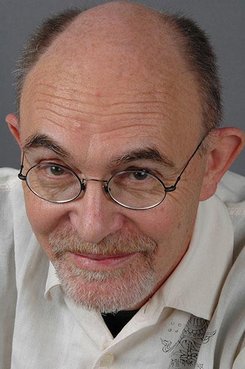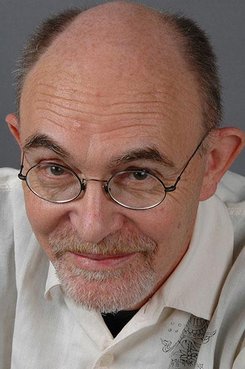Rencontre
Selon Gérard Macé
�2 - �4 déc. 2015
�2 - �4 déc. 2015

L'événement est terminé
"Je me propose de commenter quelques-uns de mes livres, afin d’éclairer autant que possible les dialogues des 2, 3 et 4 décembre.
Le jardin des langues (1974), Les balcons de Babel (1977) Bois dormant (1983)
Mes trois premiers livres forment une suite de poèmes en prose, je les ai d’ailleurs regroupés en poche, dans la collection Poésie/Gallimard.
Je les vois aujourd’hui comme une retraversée du chaos linguistique de l’enfance, et du ruban sonore qu’est le langage. Pour voir se reformer, après une apparente dictée de l’inconscient, une prose plus régulière, et même plus normée. En témoigne l’usage presque exclusif de l’italique dans le premier volume, puis l’apparition progressive du romain qui prend de plus en plus de place, au fur et à mesure que s’affirme la signification, en même temps que se met en place un univers et des thèmes qu’on retrouvera dans tous les livres suivants. Comme si l’opération poétique consistait (et je crois que c’est la réalité) à fabriquer du futur en se retournant vers le passé. C’est ce qu’on nommait autrefois une « vita nuova », et c’est ce qui a fait croire à une inspiration prophétique du poète, pourtant placée sous le signe de la mémoire.
« Le jardin des langues »: le titre me vient du jardin des Plantes, que je fréquentais quand j’habitais à côté. J’ai été fasciné par le parterre d’étiquettes à certains endroits, par l’illusion d’un langage en pleine terre qui m’a fait revivre la séparation entre nature et culture, mais aussi leurs inévitables correspondances. Cependant, les linguistes nous aident à le comprendre, les mots ne sont pas des étiquettes, et si le langage est un instrument, c’est plus un instrument musical qu’un outil.
« Les balcons de Babel »: le titre doit beaucoup au célèbre tableau de Brueghel, mais aussi au balbutiement, voire au babil de l’enfance. Le livre est conçu comme une longue parenthèse, avec un prologue et un épilogue dans une prose régulière (et ponctuée), alors que le centre est fait de parenthèses qui s’ouvrent dans la parenthèse, comme « Le jardin des langues », forme qui marque la dérive du monologue intérieur, et les dérives de l’association.
« Bois dormant » : le titre m’est venu devant une oeuvre de Markus Raetz, qui représente à l’aide de branches mortes et de brindilles le visage d’une femme endormie. Il s’est imposé vers la fin de l’écriture, donnant son unité à l’ensemble, en l’orientant vers l’univers des contes, ou du moins ce qu’il devient dans l’esprit d’un adulte, et dans l’écriture poétique.
Ex libris (Nerval, Corbière, Rimbaud, Mallarmé, Segalen)
Ce livre qui regroupe des essais sur des poètes familiers résume mon roman d’apprentissage.
Apprentissage de lecteur, qui passe de l’autre côté en écrivant.
Au moment où j’écrivais ces essais, dans les années soixante-dix, le paysage était dominé par le structuralisme, le nouveau roman puis Tel Quel, qui imposaient de s’en remettre au texte, et au texte seul, comme si les écrivains n’étaient pas des vivants. D’un autre côté je voyais bien ce qu’avait de suranné la biographie telle qu’on la pratiquait auparavant, et plus encore l’explication de l’œuvre par la vie.
J’ai donc tenté de tresser l’une et l’autre, de recourir sans le dire clairement à la conception des « Vies », qui privilégiaient des moments forts et significatifs, plutôt que l’illusoire exhaustivité. Tout en m’interrogeant, d’un bout à l’autre, sur « le mystère dans les lettres », comme disait Mallarmé, et son possible éclaircissement.
Rome ou le firmament (1983)
J’ai été privé d’études classiques, mais puisque je ne pouvais entrer par la porte, je suis entré par la fenêtre.
Je m’explique : un instituteur à la fin de l’école primaire, par préjugé social (j’en ai le souvenir vif et cuisant) m’a orienté en moderne, dans le lycée de banlieue où j’ai fait mes études. Mais cet homme dont je n’ai pas oublié le nom m’a rendu service. Grâce à lui, la mythologie et tout ce qui avait trait à l’Antiquité, le lointain temporel et plus tard le lointain dans l’espace, sont devenus des sujets de rêverie, plutôt que des objets de connaissance.
De ce point de vue, Rome a beaucoup compté. J’y suis allé une première fois en 1970, à la découverte du baroque (je n’ai même pas mis les pieds au Forum), et particulièrement sur les traces du Bernin et de Borromini. Puis j’ai eu la chance d’y vivre, de 1975 à 1977, à la Villa Médicis.
C’est plus tard que j’ai écrit sur le Bernin, Borromini et Piranèse (dont Fellini, par exemple, est un merveilleux continuateur), car il fallait que j’éprouve le besoin de retrouver cette réalité vécue, mais nimbée par l’aura du souvenir. D’où sans doute la première phrase: « A Rome on ne fait jamais que revenir ».
Ce livre a eu depuis une autre conséquence. Je suis retourné à Rome, entre autres, lorsqu’un projet de livre illustré a pris naissance à partir de mon texte. J’avais choisi Isabel Munoz pour faire les photos, je l’ai promenée dans Rome qu’elle découvrait, lui expliquant mon point de vue avant qu’elle ne passe à l’action. A la suite de quoi elle m’a convaincu de me mettre à la photo, alors que je n’avais même pas d’appareil.
Le manteau de Fortuny (1987)
J’ai attendu longtemps avant de lire la Recherche. Je veux dire intégralement, et de la première à la dernière ligne. J’ai profité d’un début d’été propice, et j’ai mis deux mois pendant lesquels j’ai vécu avec Proust et ses personnages, mais plus encore dans un état second, entre l’enchantement et l’hypnose. C’est sans aucun doute ma plus grande expérience de lecteur, et je me souviens de mon inquiétude au fur et à mesure que je m’avançais vers la fin. Que faire après, comment vivre (et pas seulement lire) sans cette intensité, sans cette profondeur, sans se consacrer à l’essentiel, bercé par la voix du narrateur ?
La réponse est venue des mois plus tard, quand j’ai retrouvé le nom de Fortuny dans un guide de Venise. Je n’avais pas prêté attention à ce nom pendant ma lecture, mais il revenait comme un détail révélateur, et comme un sésame, qui me permettait de préparer un voyage, mais surtout de reparcourir la Recherche en entier. Son esthétique, ses couleurs orientales, les corps absents d’Esther et de Shéhérazade, et la métaphore même du manuscrit, que Proust a lui-même comparé à une robe. Avec les fameuses « paperoles », il ressemble d’ailleurs à ce qu’on appelle un « patron » en couture.
Du même coup je découvrais l’importance des étoffes pour ma propre sensibilité, ce qui est beaucoup plus qu’un bénéfice secondaire.
Le dernier des Egyptiens (1989)
Mon intérêt pour Champollion, déjà présent dans Les trois coffrets, date d’une exposition consacrée aux origines de l’écriture, qui eut lieu au Grand Palais au début des années quatre-vingts. Une reproduction de la pierre de Rosette, le déchiffrement qui fut le projet d’une vie, le génie à l’état pur, mais aussi la mise en œuvre d’une méthode, m’ont donné envie d’en savoir plus sur l’homme qui s’était tué à la tâche, pour ressusciter une civilisation en faisant œuvre de linguiste.
Plus tard c’est une invitation au Caire, et une lettre de Champollion racontant qu’on lui avait fait la lecture du Dernier des Mohicans pendant une crise de goutte, qui m’ont donné l’envie d’imaginer, pendant une rêverie assez brève, ce que cette lecture pouvait déclencher dans l’esprit du déchiffreur des hiéroglyphes. Une autre lettre m’a révélé une présentation d’Indiens Osage au Musée du Louvre, à laquelle Champollion avait assisté. Toutes ces pistes, tous ces croisements m’ont permis d’élargir le point de vue linguistique, jusqu’à des questions qu’on pourrait qualifier sans peine d’anthropologiques.
Après coup, je me suis aperçu que la scène initiale renvoyait au souvenir de ma grand-mère maternelle, qui allongeait une jambe demeurée raide après un accident de travail (elle était tombée d’une charrette), pendant qu’on lui faisait la lecture du journal ou du courrier, parce qu’elle était illettrée.
Le goût de l’homme (2002)
L’ethnographie, l’anthropologie sont des réservoirs de fables, une continuation de la mythologie dans le présent, après son interprétation depuis l’Antiquité. Double exotisme, dans l’espace et dans le temps.
Le point de départ, c’est un doute à propos de Dieu d’eau, le livre de Marcel Griaule que je n’ai suffisamment pu lire sans éprouver un grand malaise. Après m’être interrogé sur Ogotemmelli, l'informateur de Griaule, puis sur Griaule lui-même en Ethiopie (Le flambeur d’hommes ne plaide pas en sa faveur), il m’a semblé que le livre devenu fameux jusque chez les Dogons eux-mêmes, qui le récitent volontiers aux touristes, était une création mensongère, et l’illusion d’une totalité, parce que son auteur avait été pris d’une ambition littéraire qu’il n’était pas capable d’assumer. Se prenant pour Hésiode, il invente une mythologie qu’aucun Dogon n’a jamais eue en tête, au moins dans cette version. Il est vrai que nous avons fait la même chose avec la mythologie grecque, dont il ne nous vient pas suffisamment à l’esprit que c’est la nôtre.
Par contraste, la prudence de Dumézil expliquant patiemment des textes difficiles fait partie de son charme. Et quand il extrapole à propos d’une tradition indo-européenne, il sait qu’il prend un risque, il sait même que son invention est peut-être fallacieuse. Rien de mieux pour le suivre et lui faire confiance, d’autant que l’homme est présent dans ses textes si on a l’oreille un peu fine, et qu’un portrait se dégage peu à peu, surtout dans les notes des derniers volumes. De même, l’attention flottante de Pierre Clastres chez les Guayakis, son attente dont il sait qu’elle peut être infructueuse, lui évitent une attitude surplombante, et le goût d’un savoir totalitaire.
Il est bien possible que ce triptyque forme une suite au Dernier des Egyptiens.
La mémoire aime chasser dans le noir (1993)
Je crois pouvoir dire (avec les souvenirs d’enfance, il y a toujours une marge d’erreur) que mon rapport à la photographie a commencé avec les images en noir et blanc du dictionnaire, et les romans-photos que lisait ma mère dans Confidences.
Pendant plusieurs décennies, j’ai été attentif à la photographie sans m’en rendre compte. Le
hasard a même voulu que mon premier appartement parisien ait été celui de fabricants d'objectifs, dont les héritiers s’apprêtaient à jeter des images originales de Man Ray et de Laure Albin-Guillot, que j’ai récupérées. Il faut dire qu’à l’époque, il n’y avait en France ni expositions, ni ventes aux enchères, à de rares exceptions près. Le marché de la photographie, sa reconnaissance par les institutions sont plus récents.
J’ai eu la chance de connaître Henri Cartier-Bresson dès que j’ai publié, et de devenir son ami un peu plus tard. Puis j’ai connu Boubat et Ronis, enfin des photographes d’une autre génération : Nils-Udo, Isabel Munoz qui m’a convaincu en 1996 que je pourrais photographier moi-même.
La mémoire aime chasser dans le noir précède ce passage à l’acte, que je ne prévoyais pas (mais j’aime ces surprises du destin, et tout ce qui se prépare à notre insu comme dans une chambre noire). Outre les notes qui concernent le phénomène photographique proprement dit, une autre partie concerne l’image de rêve, avant une reprise de l’ensemble sous la forme de poèmes en prose. C’est donc un livre qui n’appartient à aucun genre précis , mais qui illustre la proximité dans mon esprit de l’essai et du poème.
Mes livres se complétant les uns les autres, par tuilage ou par extensions, L’art sans paroles
(2002) peut être considéré comme une suite de La mémoire… C’est toujours le monde du silence qui m’inspire, dans une période où j’étais las de la littérature, au point de vouloir m’évader du langage. J’y suis en partie parvenu grâce à deux expériences très fortes: quelques mois pendant lesquels je n’ai vu que des films muets, quelques années pendant lesquelles je suis allé beaucoup au cirque.
Kyôto, un monde qui ressemble au monde (2000)
Mon premier voyage au Japon date de 1984, et si j’ai été ébloui par l’architecture contemporaine à Tokyo, le Japon classique à Kyoto, où il est davantage présent, m’a laissé sans voix. Je suis retourné assidûment dans les jardins qui entourent la ville, et qui sont d’inspiration si variée. Je ne me préoccupais pas de comprendre, je me laissais plutôt envahir par ces paysages qui sont autant d’univers, de représentations du monde qu’on pourrait prendre pour des paysages mentaux mais qui s’inspirent le plus souvent de sites réels, et parfois avec une grande précision.
En 1999, j’ai voulu séjourner plus longtemps à Kyôto, pour m’imprégner davantage encore de ces espaces à la fois immenses et circonscrits, en même temps que je me documentais (Sur un fondblanc, de Vera Linhartova m’a beaucoup aidé). Mais ce qui a déclenché l’écriture, c’est le souvenir d’un « jardin japonais », ou ce qu’on appelait ainsi dans les années cinquante, posé sur la boîte à ouvrage de ma mère. La première page a entraîné toutes les autres.
En même temps je photographiais les lieux dans des moments parfois privilégiés (ainsi le
Ginkakuji après une nuit d’orage), et rentré à Paris je me suis aperçu que l’écriture et les images se complétaient, se renforçaient même. C’est la première fois que mes propres photos ont accompagné mes textes, et je dois dire que cela m’a donné envie de recommencer.
Un lecteur a remarqué que j’aimais les lieux circonscrits, qui sont à chaque fois des images du monde, ou l’idée qu’on s’en fait. La Rome baroque, les jardins de Kyôto, les chefferies bamiléké lui donnent raison.
Filles de la mémoire (2007), Promesse, tour et prestige (2009), Homère au royaume des morts a les yeux ouverts (2014)
Retour au poème, et même au vers, qui doit presque tout à l’enjambement, c’est-à-dire au léger décalage entre l’unité grammaticale et l’unité de sens, au rebond d’une ligne à l’autre, et à la musique, ou du moins au rythme ainsi créé. Il n’y a pas de plaisir poétique sans plaisir de l’oreille.
L’écriture du poème, qui suppose des dispositions intérieures propices (les créer, c’est la moitié du travail) est ce qu’il y a de plus miraculeux, de plus magique dans l’écriture. Tout effort disparaît, au profit d’une volupté incomparable.
J’ai l’habitude d’écrire sans manuscrit, en élaborant mentalement des passages entiers, et en les mémorisant jusqu’à ce que j’aie l’envie de passer au suivant. En somme, j’écris pour oublier, ou du moins pour faire le vide. Quel que soit le résultat, cet aspect rythmique et mémoriel définit le caractère poétique de l’écriture, à plus forte raison quand elle prend la forme du poème.
« Promesse, tour et prestige » sont les trois moments d’un tour de magie. Le titre, et l’unité du volume, me sont venus en regardant Le prestige de Christopher Nolan.
C’est en lisant Swift que s’est imposée l’image d’Homère qui n’est plus aveugle. Figure de l’inspiration retournée sur elle-même, ou négatif devenu positif, comme dans la photographie.
Pensées simples (2011) et La carte de l’empire (2014)
J’ai longtemps cherché une forme qui soit la plus simple, au point d’être invisible, et qui me permette de mêler des réflexions sur les sujets les plus divers, mais sans désordre. Les deux volumes publiés (le troisième est en cours) progressent par enchaînements subtils, par échos, associations, analogies. Il me semble que la pensée en train de se faire, le monologue intérieur, la conversation même avancent de la sorte, sans coqs à l’âne mais avec une logique qui n’est pas préméditée.
Si j’avais à nommer quelques illustres prédécesseurs, ce seraient évidemment Montaigne avec ses « sauts et gambades », l’admirable et trop ignoré Joubert dont les pensées sont posthumes (et l’ordre incertain), Leopardi et son volumineux Zibaldone, savant mêli-mêlo comme son titre l’indique. Autant d’œuvres où le chemin compte davantage que le but, autant d’auteurs qui ne se pressent pas de démontrer, encore moins de conclure."
Gérard Macé
Où
Petite Salle
Quand
�2 - �4 déc. 2015