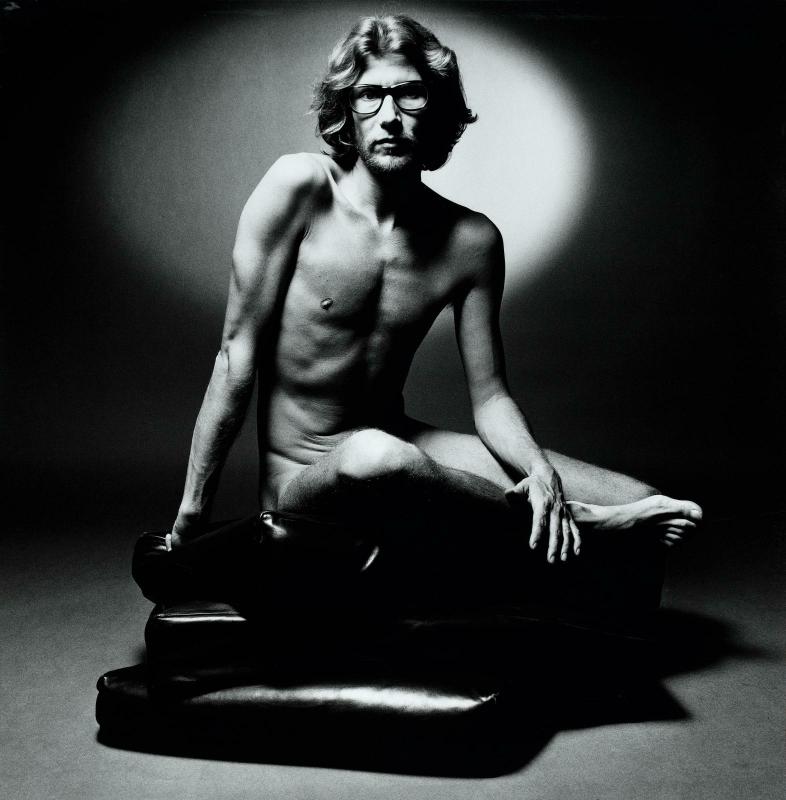Yves Saint Laurent, un regard moderne
L’exposition consacrée à Yves Saint Laurent au Centre Pompidou constitue une première pour le Musée national d'art moderne, peu accoutumé à présenter dans ses salles des modèles de haute couture. En effet, pour des raisons liées à l’histoire de l’institution, la mode ne compte pas à ce jour parmi les champs de collection, pourtant nombreux, couverts par le Musée. C’est dire tout l’intérêt que méritait la proposition par la Fondation Yves Saint Laurent-Pierre Bergé de contribuer à l’hommage exceptionnel rendu à l’un des plus grands couturiers du 20e siècle, tout juste soixante ans après son premier défilé.
C’est en parfaite harmonie avec Mouna Mekouar, qui assure, avec Madison Cox et Stéphane Janson, le commissariat général des six expositions « Yves Saint Laurent aux musées », qu’a été conçu cet accrochage au sein du Musée national d'art moderne. C’est avec elle qu’ont été choisies les œuvres qui pourraient dialoguer avec des modèles emblématiques d’Yves Saint Laurent. Cette collaboration a conduit au parcours visible aujourd’hui qui compose en treize modèles emblématiques créés entre 1965 à 1988, une sorte de rétrospective du couturier, tout en mettant en évidence sa proximité avec l’art moderne et celui de son temps.
Après des débuts rue Spontini, la maison de couture Yves Saint Laurent s’installe dès 1973 avenue Marceau, à quelques pas du Musée national d’art moderne alors situé au palais de Tokyo. Dans les salles du Musée, dont la collection était infiniment moins développée qu’aujourd’hui, Saint Laurent affûte son œil, puise les formes qui le fascinent. Il sait combien l’art moderne, celui de la ligne, du rythme ou de la couleur, est synonyme d’intemporalité.
Pour cette exposition, certains rapprochements s’imposaient naturellement. Celui entre La Blouse roumaine peinte par Matisse en 1940 et sa reprise presque littérale présentée par Saint Laurent pour sa collection automne-hiver 1981 est de ceux-là. C’est précisément au palais de Tokyo que le couturier avait découvert cette œuvre, devenue iconique, offerte par Henri Matisse à l’État français en 1953. Il lui rend directement hommage avec une blouse d’étamine de laine, brodée de sequins qui reproduisent fidèlement les motifs du vêtement folklorique.
J’ai toujours eu envie de créer cette blouse. J’aime les costumes folkloriques de l’Est. Leurs coupes sont extrêmement simples. Une blouse roumaine n’a pas d’époque. Tous ces vêtements de paysans traversent les siècles sans se démoder.
Yves Saint Laurent
La fameuse robe « Mondrian » apparaissait elle aussi un incontournable. Après quelques hésitations, liées à des impératifs de conservation, il fut décidé de présenter le modèle le plus célèbre, parmi les vingt-six réalisés par Yves Saint Laurent pour sa collection automne-hiver 1965. Placée aux côtés de l’unique peinture de la période parisienne que conserve le Musée (Composition en rouge, bleu et blanc II, 1937), cette robe en jersey illustre à elle seule cette collection manifeste : en choisissant les principes du néoplasticisme selon lesquels, d’après Mondrian « seuls les rapports purs, d’éléments constructifs purs, peuvent aboutir à la beauté pure », le couturier, âgé seulement de 29 ans, démontrait qu’à la mode, il préférait la modernité, à l’éphémère l’immuable.
D’autres modèles du couturier s’imposaient en vis-à-vis de peintures ou de sculptures de la collection du Musée. Au centre de la salle monographique consacrée à Fernand Léger, la robe créée par Saint Laurent en son hommage et brodée d’applications inspirées par des motifs de l’artiste dialogue ainsi avec sa grande sculpture Fleur polychrome (1936). Dans la salle cubiste, la cape « Aria de Bach » brodée de sequins par la maison Lesage pour la collection « Hommage aux artistes » de 1988 reprend quant à elle un papier collé de Georges Braque (1913) que Saint Laurent avait pu voir dans une exposition au Centre Pompidou l’année précédente. Aujourd’hui dans la collection de la National Gallery de Washington, ce collage est avantageusement remplacé par le Violon de Pablo Picasso peint en 1914.
De même, pour dialoguer avec l’extraordinaire robe en jersey de la collection automne-hiver 1966 inspirée à Saint Laurent par l’artiste Pop américain Tom Wesselmann, malheureusement absent de notre collection, c’est une peinture d’un autre artiste qui a été convoquée. Dans The Moon (2010) du peintre anglais Gary Hume, lui-même redevable de l’esthétique Pop, le bras levé d’une pom-pom girl répond tout naturellement au nu féminin qui parcourt la robe sur toute sa hauteur.
Le retour à la couleur, les jeux de textures signifiés par les pointillés qui viennent adoucir la rigueur formelle sont caractéristiques du « cubisme un peu doux » qu’affectionne Yves Saint Laurent dans les années 1980. Par son bichromatisme, une robe en crêpe de satin noire et blanche, inspirée par les costumes que l’artiste espagnol avait conçus pour les Ballets russes de Diaghilev apparaît un contrepoint idéal à Arlequin et Femme au collier peint par Picasso à Rome en 1917. Un autre modèle de Saint Laurent, dont les motifs proviennent pourtant du costume du prestidigitateur chinois de Parade s’inscrit tout naturellement au centre de la salle consacrée à Robert et Sonia Delaunay, tant ces deux artistes et le couturier semblent animés par une volonté commune : mettre la couleur en mouvement. Enfin, il est apparu rapidement évident que l’antichambre réalisée par Yaacov Agam à la demande de Georges et Claude Pompidou pour le palais de l’Élysée en 1971 était comme faite pour accueillir trois modèles aux motifs « Op » conçus par Yves Saint Laurent à partir de tissus fournis par la maison Abraham. Le grand collage de Victor Vasarely, Alom (1966) accroché dans la salle pour cette occasion, vient rappeler combien la volonté de l’artiste d’origine hongroise de diffuser l’esthétique Op dans l’ensemble de la société, remporta un immense succès et que le couturier fut loin d’y rester insensible.
En présentant les modèles d’Yves Saint Laurent au sein de la collection du Musée national d’art moderne, il s’agissait aussi de prouver, au-delà des rapprochements évidents, combien le couturier a été tout entier habité par la modernité. Aux quelques confrontations attendues se sont peu à peu ajoutés des rapprochements visuels davantage arbitraires, sans céder toutefois à l’attrait d’associations uniquement séduisantes.
Rien ne rapproche a priori Saint Laurent du surréalisme. Tout pourtant. Notamment l’intérêt que portent le couturier comme André Breton, aux arts extra-occidentaux. Le décloisonnement entre les cultures que tous deux appelaient de leurs vœux et qui prend forme, chez le couturier, avec sa collection printemps-été 1967 rendant hommage à l’art africain, permet deux nouvelles confrontations. L’une occupe la salle consacrée au mur de l’atelier d’André Breton devant lequel est placé un manteau en raphia teint en orange et au col en macramé brodé de perles en bois. La seconde met en scène l’étonnante robe noire « Bambara » recouverte de perles et de plaques de rhodoïd, véritable « totem » aux seins coniques, à proximité immédiate des sculptures surréalistes d’Alberto Giacometti.
J’aime d’autres peintres, mais ceux que j’ai choisis étaient proches de mon travail [...]. Mondrian, bien sûr, qui fut le premier que j’osai approcher en 1965 et dont la rigueur ne pouvait que me séduire, mais également Matisse, Braque, Picasso, Bonnard, Léger. Comment aurais-je pu résister au Pop Art qui fut l’expression de ma jeunesse ?
Yves Saint Laurent
Il en va de même pour le rapprochement entre un chef-d’œuvre de Martial Raysse, Made in Japan, La Grande Odalisque (1964) et le fameux manteau court en fourrure de renard teint en vert réalisé pour la collection printemps-été 1971. Initialement intitulée « collection Quarante », celle-ci devait être renommée quelques mois plus tard « collection Scandale » tant les pièces du couturier, inspirées par la mode sous l’Occupation, provoquèrent l’ire de la critique. Même esprit kitsch, même désir de désacralisation, même exercice d’appropriation, même couleur enfin, pourtant inusitée, symbole de duplicité. Ce dialogue qui s’imposait de lui-même est corroboré par la rencontre en 1966 d’Yves Saint Laurent et de Martial Raysse autour d’un spectacle du chorégraphe Roland Petit.
Au début du projet, le désir de montrer la diversité des matières dans le répertoire du couturier s’était très tôt manifesté dans le choix d’un des manteaux en plumes d’autruches qu’Yves Saint Laurent avait réalisé dans les années 1980 pour la danseuse Zizi Jeanmaire. Celui-ci aurait dû être rapproché du monumental Deep (1953) de Jackson Pollock que le couturier avait pu admirer dans la rétrospective consacrée par le Centre Pompidou au peintre américain en 1982. L’extrême fragilité du manteau devait malheureusement nous contraindre à renoncer à ce rapprochement pourtant séduisant. Imaginé tardivement, le dialogue entre une robe minimaliste de 1965 et une peinture noire et blanche d’Ellsworth Kelly (Black White, 1988) devait dissiper tout regret. Cette nouvelle confrontation s’impose avec évidence tant Kelly et Saint Laurent, sans s’être rencontrés, sont tous deux parvenus, sous l’égide d’Henri Matisse, à une parfaite synthèse de la ligne pure et de la puissance chromatique. On notera d’ailleurs que Kelly a fait lui-même œuvre de couturier, au moins à une unique occasion.
Dès les premières réunions de travail avec la Fondation, les robes cocktails de la collection « Pop » de 1966 nous incitaient à un rapprochement avec les paysages abstraits (2010), de l’artiste libanaise Etel Adnan. Fallait-il pour autant oser cette confrontation en apparence si peu fondée ? Dans la collection Pop, il est vrai peu fournie du Centre Pompidou, Jim Dine, Martial Raysse ou même Kiki Kogelnik n’avaient-ils pas davantage leur place auprès de ces robes acidulées ? La disparition de l’artiste en novembre 2021, à laquelle nous voulions sans attendre rendre hommage, conforta pourtant notre première intuition. La rencontre entre ces petits formats d’une grande puissance plastique, et la robe « Soleil » apparaît d’ailleurs guidée par une volonté commune : reproduire, sans représenter, allier l’intelligibilité de la ligne et celle des chaudes couleurs de la Méditerranée. ◼
À lire aussi
Dans l'agenda
À gauche, cape brodée Yves Saint Laurent, Aria de Bach, inspiré par Georges Braque pour la collection haute couture printemps-été 1988. À droite, Le Violon de Pablo Picasso, 1914.
© Centre Pompidou / Hélène Mauri